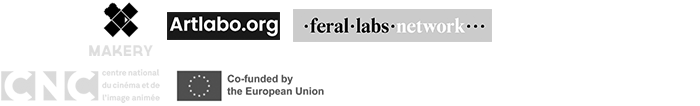ArtLabo Retreat
Les ArtLabo Retreats font partie de Feral Labs Network et sont cofinancés par l’Union Européenne – Feral Labs (2019-2021) & Rewilding Cultures (2022-2026)
Les ArtLabo Retreats font partie de Feral Labs Network et sont cofinancés par l’Union Européenne – Feral Labs (2019-2021) & Rewilding Cultures (2022-2026)
par Lyndsey Walsh
Initialement publié dans Makery le 25 juillet 2025
Le voyage jusqu’au bout du monde n’a pas été aussi long que je le pensais. Après six heures de route depuis Paris et une courte traversée en vedette depuis le port de Roscoff, nous sommes arrivés sur les côtes de l’île de Batz, une petite île au large du Finistère, le département le plus occidental de France. Assis sur le toit de la Colonie du Phare, qui accueille l’ArtLabo Retreat, on comprend facilement pourquoi le Finistère tire son nom du latin « Finis Terrae », qui signifie « la fin de la Terre ».

Exploration de la zone intertidale avec l’éthnobotaniste Edouard Bal. Photo : Maya Minder.
La vaste étendue sans frontières de la mer Celtique s’étendait à l’infini dans l’Océan Atlantique, sans qu’aucune terre ne soit visible. Alors que le soleil se couchait et que la brume du soir s’installait, le caractère mystérieux de Batz, île qui semblait avoir été happée par le bord de ce monde, s’imposait à moi. J’avais beau plisser les yeux, je ne voyais rien au-delà de l’étendue aquatique, même si je savais qu’il y avait en réalité autre chose au-delà de l’horizon, puisque mon lieu de naissance se trouvait quelque part là-bas. Ce n’était que la fin de l’Europe, mais cette simple pensée avait néanmoins quelque chose de définitif.
L’ArtLabo Retreat sur Batz, organisée par ART2M/Makery en partenariat avec La Gare, Centre d’art et de design du Relecq-Kerhuon près de Brest, et cette année avec ses nouveaux partenaires n-Kerminy, lieu d’agriculture en arts et la Société d’Art Mécatronique de Suisse (SGMK), tenait sa troisière édition du 30 Juin au 6 Juillet. Membre du Feral Labs Network et du projet Rewilding Cultures, une coopération co-financée par l’Union Européenne, la retraite a rassemblé des artistes, designers, étudiants, scientifiques, et plus encore pour explorer les terres et les eaux de Batz tout en cartographiant et en naviguant à travers les complexités et les matérialités des paysages côtiers. Elle a également étendu l’horizon de ses investigations au travers du programme Archipelago, une coopération internationale art&science avec des artistes de Suisse (SGMK) et du Japon (Sonda Studio), soutenue par Pro Helvetia, la fondation suisse pour la culture. Au niveau local, La Gare était soutenue par le programme coopération international de la Région Bretagne et par la Drac Bretagne.
En participant à cette retraite en tant que chercheur artistique, je me suis retrouvée à tituber sur un terrain accidenté, ballotté par les marées qui, tout comme les domaines de la science et de la culture, ont fait l’objet de débats séculaires sur la manière dont nous percevons et comprenons les territoires côtiers.
Même si les côtes sont une caractéristique écologique omniprésente dans notre monde et constituent le site le plus important pour la plupart des grandes villes et habitats humains, les zones côtières sont uniques en ce sens que les espaces terrestres et aquatiques interagissent pour façonner le développement de la vie humaine et non humaine. Ces régions du monde ne sont pas seulement confrontées à des changements dramatiques dus à des phénomènes écologiques en cours, tels que les variations des marées et montées des eaux, les événements météorologiques, les changements de salinité et l’érosion des sols. Elles sont également fortement touchées par les activités humaines, et leur statut a le pouvoir de façonner la continuité de la vie et de la culture humaines.

Apprendre sur les algues comestibles avec Edouard Bal. Photo : Marina Pirot

Le secteur du camp. Photo : Maya Minder.
Les territoires côtiers ont été le théâtre de certains des événements les plus marquants de l’histoire de la planète. Ils ont notamment servi de premiers points d’ancrage entre la terre et l’eau pour la vie qui a émergé des mers primitives de notre planète.
Les lichens font partie des organismes qui ont osé sortir des profondeurs marines pour s’aventurer sur la terre ferme. L’évolution chronologique des lichens fait l’objet d’un débat scientifique controversé depuis une vingtaine d’années. Cependant, en 2019, un article publié par Matthew Nelson et ses collègues a affirmé que l’arrivée des lichens sur la terre ferme n’était pas antérieure à celle des plantes vasculaires, tandis que d’autres scientifiques affirment que les fossiles pourraient suggérer une transition plus précoce vers la vie terrestre. Bien que l’étude de Nelson reste le consensus actuel, elle ne repose pas sur la présence de lichens dans les archives fossiles, mais plutôt sur l’utilisation de phylogénies calibrées dans le temps, des arbres généalogiques évolutifs créés à partir de l’analyse moléculaire de l’ADN de différentes espèces de champignons et d’algues qui composent l’holobionte que nous connaissons sous le nom de lichens (1).
Le scientifique Tony Robinet, professeur assistant à la Station Marine de Concarneau (Musée National d’Histoire Naturelle) et participant à ArtLabo, s’est passionné pour l’histoire de l’origine des lichens, qui constituent un point de transition entre la vie marine et la vie terrestre. Il m’a expliqué que la formation d’une relation symbiotique entre les champignons et les algues a permis à ces dernières de quitter leur milieu aquatique grâce à une nouvelle capacité à survivre à la sécheresse sous la protection de leur symbiote fongique. Les mystères et la complexité qui entourent les origines des lichens sur terre seront le thème principal du projet cinématographique actuel du Dr Robinet, en collaboration avec le musicien et artiste sonore Jean-Baptiste Masson, qu’ils ont en partie produit pendant leur séjour à ArtLabo Retreat.

Tout en passant la journée à filmer le lichen qui recouvre tout sur l’île, des rochers aux arbres, en passant par la maison du Corsaire abandonnée, autrefois utilisée par les corsaires pour surveiller l’entrée dans le chenal entre Batz et Roscoff, Tony a traduit la dynamique vivante du lichen, soulignant comment la profondeur des marées peut être déduite en fonction des types de lichen présents sur les rochers et la signification des différentes textures et motifs formés par la multitude d’espèces coexistant sur l’île.

Le Trou du Serpent, Île de Batz, Photo : Lyndsey Walsh
Mais l’Île de Batz n’est pas seulement un site où l’on peut percer les secrets de l’histoire naturelle des lichens. L’île est également connue pour la bataille mythologique qui s’y est déroulée au VIe siècle entre Saint Pol Aurélien, un évêque végétarien gallois, et un dangereux serpent de mer, que Saint Pol a repoussé à la mer à l’endroit aujourd’hui connu sous le nom de Trou du Serpent afin de rendre l’île habitable. Bien que cette histoire reste un mythe, elle a retenu mon attention en tant que potentiel artefact de construction culturelle d’informations sur l’histoire naturelle de l’île. Le chercheur Scholar Robert France note que dans les mythes et les contes populaires issus de la mer, les serpents de mer représentent souvent des menaces environnementales réelles ou des catastrophes qui se sont produites.
Pour les événements écologiques qui ne laissent aucune trace pouvant permettre à la science de mener des recherches, ces récits restent de petits indices sur les possibles manières de vivre des premiers habitants, humains et non humains, de notre planète. Le thème de ces possibilités, à la lumière d’autres récits culturels mondiaux qui utilisent des monstres pour faciliter la connaissance de l’histoire naturelle et des traumatismes écologiques, est devenu le sujet de ma conférence-performance organisée lors de notre journée portes ouvertes de clôture de l’ArtLabo, avec une reconstitution captivante de la bataille entre Saint Pol et le serpent de mer, mettant en scène le végétarien gallois de la retraite, Steffan Jones-Hughes, qui est également directeur de la Oriel Davies Gallery, et les artistes Gweni Llwyd, Corinna Mattner et l’étudiante Hanaé Laporte-Bruto, incarnant le féroce serpent de mer en revêtant des costumes d’algues confectionnés par Mattner.

Le serpent de mer, mis en scène par Gweni Llwyd, Corinna Mattner, Hanaé Laporte–Bruto. Photo : Francois Robin.
Bien que les habitants y voient une métaphore de l’éradication du paganisme celtique par le christianisme, le mythe du serpent de mer reste un mystère et la recherche de moyens de coopérer ou d’établir des relations entre différentes espèces est une caractéristique essentielle de la préservation de la vie côtière. Tanguy Grall, brasseur, docteur en cosmologie et habitant de la région, a souligné, lors d’une conférence et d’une lecture de manifeste lors de la journée portes ouvertes, comment sa micro-brasserie PAB s’est inspirée de ses recherches sur la science de la fermentation pour explorer, selon les termes de la philosophe Karen Barad, « l’intra-action avec les micro-organismes », ce qui a conduit PAB à produire sa bière à partir de fleurs sauvages locales et d’autres plantes. Pour les habitants de Batz, la flore locale n’est pas la seule caractéristique importante de l’île, car historiquement, les algues ont également constitué sa principale ressource avant le XXe siècle. De nombreux participants à ArtLabo ont trouvé leur propre façon de travailler avec les algues, en les récoltant, en les transformant en textiles, en les cuisinant et en explorant d’autres modes d’exploration des matériaux.

Cuir de kombu fourni par le desginer Tanguy Mélinand. Photo : Ewen Chardronnet
Les algues ne sont pas seulement importantes d’un point de vue historique pour l’île de Batz, elles constituent également un organisme essentiel dans les écosystèmes côtiers. Les algues jouent un rôle vital dans les réseaux trophiques en tant que producteurs primaires, grâce à leur rôle d’organismes photosynthétiques largement consommés par d’autres organismes marins. Elles sont également essentielles au développement et à la santé des écosystèmes côtiers, car elles fournissent un habitat crucial à de nombreuses espèces aquatiques, servent de nurseries pour les organismes juvéniles, sont une source d’oxygène et contribuent à de nombreuses activités humaines côtières, notamment l’alimentation, la pharmacie, la fabrication d’engrais et l’alimentation animale (2).

Photo sous-marine par Clémence Curty durant la semaine. Lire son journal de bord. Credit: Clémence Curty
Notre séjour à l’île de Batz touchant à sa fin, un tiers des participants se sont rendus à l’intérieur des terres, au château de Kerminy, un domaine privé abritant une micro-ferme maraîchère expérimentale et une résidence d’artistes autonome qui combine des pratiques agricoles transformatrices et des expériences sonores somatiques. Park, le « parcours d’agriculture en art » estival, est ouvert tous les samedis pendant la saison pour des promenades sonores à la découverte d’œuvres d’art dans le domaine de l’écologie acoustique et du land art. L’ArtLabo Retreat avait pour objectif d’explorer pour la première fois le thème de la terre dans le sud du Finistère, en travaillant sur l’art sonore durant la résidence à Kerminy et l’événement Fluxon, ainsi que sur les bassins versants et la relation entre la terre et la mer, avec des visites prévues à la station marine de Concarneau et aux rias des rivières Aven et Belon. L’impact du monde côtier est donc resté présent dans nos explorations quotidiennes malgré notre changement de lieu.

Lyndsey Walsh visitant la production ostréicoles dans l’estuaire du Belon. Photo : Ewen Chardronnet
Lors de notre visite à la Station Marine de Concarneau, nous avons constaté des changements dans le paysage côtier, désormais situé au sud du Finistère. À proximité de Concarneau se trouvent les parcs à huîtres de l’estuaire du Belon, où la variété régionale d’huîtres plates, réputées pour être un mets délicat de Bretagne, côtoie la variété Japonica cultivée. Ces estuaires descendent le long de la côte sud de la Bretagne avant de se jeter dans l’océan Atlantique. À Concarneau, nous avons rencontré le Dr Samuel Iglesias, qui nous a fait part de ses recherches sur le catalogage et la normalisation des données relatives à la diversité des poissons cartilagineux de l’Atlantique Nord-Est et de la Méditerranée (3). Bien que la biodiversité de l’écosystème côtier que nous avons visité soit abondante, le Dr Inglesias nous a rappelé que la plupart des espèces étudiées dans le cadre de ses recherches étaient gravement menacées ou en voie d’extinction.

Maya Minder (SGMK), Toru Oyama (Sonda Studio) et Lyndsey Walsh avec le Dr. Inglesias à la Station Marine de Concarneau. Photo : Ewen Chardronnet

L’artiste Maya Minder (SGMK) et le Dr. Tony Robinet discutant de la culture de microalgues au Marinarium de la Station Marine. Photo : Ewen Chardronnet

Lyndsey Walsh avec Bernard Bourlès, taxidermiste marin, dans son atelier à la station marine. Photo : Ewen Chardronnet


Visite des équipements de la station marine avec le Dr. Tony Robinet. Photo : Ewen Chardronnet
Les êtres humains dépendent fortement des environnements côtiers pour accéder aux ressources, au transport maritime, aux ports, etc. Les effets anthropiques de ces activités sur l’environnement mettent également les côtes en danger en raison des polluants anthropiques, de la surpêche, de la mauvaise gestion des zones côtières, etc. (4).

Performance « L’appel du vide », photo de Lyndsey Walsh. Crédit : Toru Oyama
Ces frictions permanentes entre les capacités humaines et non humaines sur ces territoires côtiers ont inspiré une performance finale intitulée « L’appel du vide », créée par l’artiste Maya Minder, l’artiste Corinna Mattner, l’artiste sonore Pom Bouvier-b et moi-même. Il nous semblait approprié, alors que nous résidions à « la fin du monde » en Bretagne, de tenter de trouver un moyen d’embrasser « l’appel du vide », qui fait souvent référence au désir de s’aventurer dans l’inconnu malgré les risques encourus.
Dans cette performance, nous avons invité les participants à tenter de se laver de leur ego et de leur moi humain à l’aide d’un savon que nous avions fabriqué à partir d’algues que nous avions récoltées nous-mêmes. Après le rituel de lavage, les participants ont été invités à trouver des moyens de s’engager dans des perspectives multispécifiques de soins personnels, facilitées par la consommation de kombu et de tisanes sauvages et le port de masques faciaux à base d’algues, tandis que Bouvier-b réalisait une performance sonore improvisée, suivie d’une méditation guidée par la voix enregistrée de Minder sur les possibilités inconnues au-delà de l’humain.

Performance « L’appel du vide », photo avec Pom Bouvier-b, Maya Minder, et Corinna Mattner. Crédit : Toru Oyama.
L’avenir des écosystèmes côtiers reste encore à déterminer. Il peut sembler ridicule d’affirmer que ce voyage au bout du monde m’a rendue encore plus consciente que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du monde. C’est à nous de décider comment nous allons agir et tendre la main pour nouer des relations avec les espèces avec lesquelles nous partageons ces paysages. Nous devons décider ensemble de la meilleure façon d’avancer vers l’inconnu.

Concert live de Pom & Poutr lors de la « Fluxnight » finale concluant l’ArtLabo Retreat et la semaine Fluxon au château de Kerminy. En physique, un fluwon est une quasi-particule décrivant un quantum de flux électromagnétique. Photo : Ewen Chardronnet
Notes :
(1) Nelsen MP, Lücking R, Boyce CK, Lumbsch HT, Ree RH. No support for the emergence of lichens prior to the evolution of vascular plants. Geobiology. 2020; 18: 3–13. https://doi.org/10.1111/gbi.12369
(2) Cotas, J.; Gomes, L.; Pacheco, D.; Pereira, L. Ecosystem Services Provided by Seaweeds. Hydrobiology 2023, 2, 75-96. https://doi.org/10.3390/hydrobiology2010006
(3) Iglésias S.P., 2012. – Chondrichthyans from the North-eastern Atlantic and the Mediterranean (A natural classification based on collection specimens, with DNA barcodes and standardized photographs), Volume I (plates), Provisional version 06, 01 April 2012. 83p. http://www.mnhn.fr/iccanam.
(4) Jean-Claude Dauvin, The main characteristics, problems, and prospects for Western European coastal seas,
Marine Pollution Bulletin, Volume 57, Issues 1–5, 2008, Pages 22-40, ISSN 0025-326X, https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2007.10.016.
par Chrysa Chouliara
Initialement publié dans Makery le 12 août 2025

credit: Kaascat
Une île est plus qu’une simple formation géographique : c’est une métaphore, un symbole de possibilités. Fragment de terre entouré d’eau, l’île incarne la séparation, l’autosuffisance, la résilience et la réinvention. Déconnectée du continent et de ses systèmes dominants, l’île devient un espace où peuvent émerger des réalités alternatives, une sorte de laboratoire pour de nouvelles valeurs, esthétiques et modes de vie.
Parfois, une île est bien plus qu’un simple souvenir d’enfance. Elle devient un lieu de rencontre où des professionnels du monde entier se réunissent pour échanger des idées et tisser des liens. Parmi les participants à l’ArtLabo Retreat 2025 figurent des étudiants, des artistes, des cinéastes, des créateurs de mode, des praticiens de l’écosomatique et des musiciens, ainsi que des concepteurs de jeux vidéo et des scientifiques. La diversité de leurs compétences s’avérera cruciale au cours de cette retraite de deux semaines, où chacun enseignera aux autres et où des collaborations improvisées verront le jour.
L’île de Batz, petite île d’environ 450 habitants nichée dans la Manche, a quelque chose de particulier. Au début du XVIIe siècle, l’envasement progressif des zones orientales de l’île a empêché la culture du lin et du chanvre, deux plantes essentielles à l’industrie textile. Les algues sont alors devenues la principale ressource de l’île jusqu’au XIXe siècle. Elles étaient utilisées à diverses fins, notamment comme aliment pour le bétail (les vaches paissaient des espèces comme la Palmaria palmata, ou Dulse), pour l’enrichissement des sols et dans la production de verre et de savon. Le commerce s’est étendu au-delà de l’usage local, la potasse (un ingrédient essentiel dans la fabrication du verre) étant exportée vers d’autres régions.
Peut-être inspiré par cette histoire, l’Artlabo Retreat est divisé en différents groupes qui s’apprêtent à utiliser les algues dans le cadre de leurs recherches sur l’île, qu’il s’agisse de son, d’image, de mode, et de médias. À marée basse, une riche forêt aquatique se dévoile alors que nous marchons parmi les rochers vers la mer avec l’ethnobotaniste Edouard Bal. Équipés de grands seaux jaunes, nous apprenons à récolter les algues : il faut uniquement prendre celles qui sont attachées aux rochers, car celles qui flottent librement sont probablement déjà en décomposition. J’essaie toutes les variétés, appréciant leur goût brut et familier.

Récolte d’algues. De gauche à droite, photos de Marina Pirot & Kaascat
Les algues peuvent être classées en trois grands groupes selon leur couleur : brunes, rouges et vertes. Les botanistes les appellent respectivement Phaeophyceae, Rhodophyceae, et Chlorophyceae. Au cours de la première semaine d’ArtLabo, ces trois types de matières servent de sources d’inspiration, de matières premières pour la fabrication de tissus et de bioplastiques, de composants conducteurs dans des expérimentations, d’éléments clés dans des performances et de touches décoratives dans tout le camp.
Le lendemain soir, alors que nous regardions le film Umi No Oya, nous grignotons des préparartions délicieuses à base d’algues. Le documentaire de Maya Minder et Ewen Chardronnet (rédacteur en chef de Makery) raconte l’histoire de Kathleen Drew-Baker, l’algologue dont les recherches ont révolutionné la culture de l’algue nori au Japon. Le film explore sa découverte cruciale du cycle de vie des algues rouges, qui a permis le développement des techniques modernes de culture de nori dans le Japon d’après-guerre. Bien qu’elle ait dû lutter en tant que femme dans le monde scientifique occidental d’avant-guerre – son mariage avec un collègue de l’université de Manchester l’empêchait de percevoir un salaire -, Kathleen Drew-Baker est aujourd’hui vénérée comme une déesse dans la tradition shintoïste au Japon, parfois appelée « umi no oya », « mère de la mer », sans avoir jamais mis les pieds au Japon.
Umi No Oya (2025), trailer (sous-titres disponibles avec le bouton CC) :
Maya Minder est une artiste basée à Zurich et à Paris, travaillant à la croisée du biohacking, de la culture alimentaire et du design spéculatif. Sur l’île, en compagnie de Corina Mattner, artiste, créatrice de mode et militante, elles animent un atelier où les algues sont transformées en tissu, à l’aide de glycérine. « Je suis obsédée par la glycérine. Elle est à la fois hydrophile et lipophile, ce qui en fait un matériau incroyable à travailler », explique Maya alors que le groupe commence à traiter les algues récoltées. Une fois séché, le tissu ressemble à du cuir translucide. Il est rapidement transformé en créations uniques, cousues avec des pièces vintage. Le groupe bénéficie du soutien de Violaine Buet, conceptrice-designer expérimentée dans le domaine des algues, originaire du sud de la Bretagne.
Le principe du camp est de « mentorer » un tiers d’étudiants en art, design, arts sonores et arts média, ainsi que des étudiants de troisième cycle, en leur offrant la possibilité d’approfondir leurs connaissances dans le cadre informel des ateliers, d’établir des contacts et de consolider des réseaux qui les aideront dans leur développement professionnel.

Corinna Mattner. Photo François Robin

De gauche à droite : Anaïs Valdher Untersteller, étudiante en design, avec Maya Minder, et Elisa Chaveneau, étudiante en art, avec Corinna Mattner dans le laboratoire des algues. Photos par Elisa Chaveneau
C’est déjà le milieu de la semaine lorsque le groupe repart avec Edouard Bal— cette fois-ci pour cueillir des plantes sauvages comestibles. Ce soir-là, nous avons dégusté l’un des dîners les plus passionnants de la semaine, les plantes fraîchement cueillies ayant été transformés en un véritable délice gastronomique par Edouard Bal et le groupe de food design, avec la participation de Julie « cuisinerd » Tunas et de l’artiste designer Lorie Bayen El Kaïm qui collaborent toutes deux dans le cadre d’une résidence artistique de longue durée et d’un projet artistique sur les méthodes de cuisson et les habitudes alimentaires avec La Gare, Centre d’art et de design. Ce moment fort de la semaine a été introduit par une touchante conférence-performance donnée par Seungje Han, étudiant coréen fraichement diplômé d’un Mastère en design de la transition à l’Ecole des Beaux-Arts de Brest.

Cueillette d’algues avec l’ethnobotaniste Edouard Bal. Credit: Makery

De gauche à droite : Photos par Maya Minder, Elisa Chaveneau, Noémie Vincent-Maudry
Je nage deux fois par jour, même quand il fait froid ou qu’il pleut, ce qui n’est pas surprenant en Bretagne. C’est la fin de la semaine, et alors que le reste de l’Europe a cuit sous une vague de chaleur, ici, la température a été supportable, voire agréable, et la côte bretonne accueille une dépression atlantique alors que nous nous préparons frénétiquement pour la journée portes ouvertes de l’ArtLabo Retreat.

La plage à côté de la Colonie du Phare. Équipé d’un petit masque, j’ai nagé deux fois par jour pendant plus de 45 minutes dans une mer à 15 degrés. Ma saison de natation hivernale en Suisse m’y avait préparé. Credit : Makery
La soirée – le soleil se couche tard ici – est remplie de spectacles, de conférences, de présentations et d’une exposition sur la Colonie du Phare. Nous passons d’un endroit à l’autre, suivant le déroulement des événements.
Ryu Oyama, invité pour une résidence de 7 semaines en France et Suisse dans le cadre du programme Archipelago, mêle le son à une interprétation contemporaine de la cérémonie du thé, en utilisant un siphon pour créer de l’espuma, une technique empruntée à la gastronomie moderne et moléculaire qui apporte une texture délicate et mousseuse. Le thé, transformé en mousse, est servi de main à main avec l’aide de Pôm Bouvier B. C’est une sensation étrange et intime que de recevoir du thé sous forme d’espuma, reposant en apesanteur dans la paume de la main, comme un cadeau.

Toru Ryu Oyama et Pôm Bouvier B. Credit : Makery

Credit: Kaascat
À peine un jour plus tard, le paysage passe du bleu au vert. Les chaussures encore pleines de sable, je m’allonge dans l’herbe devant le château de Kerminy, à Rosporden, dans la magnifique région bretonne de Cornouaille. Un chat orange sympathique explore le domaine avant de disparaître dans la forêt dense qui l’entoure.
Kerminy est un espace autogéré dédié à l’expérimentation, à la recherche et à la création, fondé en 2020 par le duo artistique (n)— Dominique Leroy et Marina Pirot. Décrit comme un « lieu d’agriculture en arts », il occupe une ancienne seigneurie du XIVe siècle, avec une chapelle, un lavoir, des dépendances et des bois, nichée dans un domaine de 12,5 hectares à l’orée d’une vaste forêt. C’est ici que l’ArtLabo Retreat se concentre désormais sur le son.
Et il n’est pas difficile d’imaginer pourquoi : même la serre est remplie d’installations sonores nichées parmi des plants de tomates géants.
Dominique Leroy est un artiste sonore qui crée des installations, des expositions et des parcours sonores conçus pour nous aider à écouter un lieu. Son travail est souvent collaboratif et s’appuie sur l’utilisation d’appareils techniques recyclés ou réutilisés pour la capture et la diffusion du son, ce qu’il appelle la fabrication expérimentale d’instruments paysagers.
Marina Pirot, pour sa part, est une artiste qui travaille à la croisée de la danse et des pratiques écosomatiques. Son travail explore la relation entre le corps et l’environnement, en se concentrant sur la collecte et la transmission des connaissances gestuelles.
Kerminy n’est pas loin de la mer. Le Dr Tony Robinet nous fait visiter la station marine locale, puis nous visitons le musée (voir le reportage de Lyndsey Walsh). En tant que sculptrice, je suis fascinée par la salle de taxidermie. La peau de chaque poisson est soigneusement retirée et placée sur une réplique en polystyrène. La salle est remplie d’innombrables spécimens aux motifs et aux couleurs fascinants.
Cette semaine, tout le monde se prépare pour Fluxon, la résidence artistique et événement annuel du château. Ateliers quotidiens de mécatronique animés par Marc Dusseiller, « workshopologiste » transdisciplinaire de la SGMK (Société d’Art Mécatronique de Suisse) et Hackteria International Society se prolongent jusque tard dans la nuit, entrecoupés de conversations spontanées qui s’engagent dès le petit-déjeuner.

Discussions et expérimentations durant Fluxon. Dr. Tony Robinet (gauche) et Marina Pirot (droite). Au centre de gauche à droite : Pôm Bouvier B., Corinna Mattner, Maya Minder. Credit : Ewen Chardronnet

Le musicien Quentin Aurat explique ses hacks d’instrument à Marie-Jo de Kerminy et à l’une de ses amies dans le music hacklab. Credit : Kaascat

Le festival Fluxon de Kerminy fait partie du parcours art sonore dans le Parc du chateau, tous les samedis jusqu’au 13 septembre. Le ballon solaire Aérocène labellisé « Fluxon » flotte dans le ciel. Credit : Maya Minder

Le Dr. Tony Robinet et Toru Ryu Oyama donnent d’une conférence sur les lichens. Credit : Kaascat
« Le son est partout. La musique, c’est ce que l’on fait avec ce son », répond Pôm sans hésiter. Pôm Bouvier B. a été attirée par la musique et le son dès son plus jeune âge, mais elle a passé de nombreuses années à explorer différentes disciplines artistiques. Un véritable coup du destin, une blessure à la jambe, l’a amenée à créer des sons pour un spectacle, ravivant ainsi son lien avec la musique. Depuis lors, sa pratique est centrée sur le son, depuis plus d’une décennie. Dans l’improvisation musicale, elle a trouvé tout ce qu’elle cherchait : un espace où tous ses talents divers pouvaient converger. « L’improvisation me fait me sentir vivante. C’est comme si toutes les compétences que j’ai acquises au cours de mon parcours trouvaient enfin leur utilité. »

Pôm Bouvier B., concert à la Nuit Fluxon. Credit : Makery
L’artiste noise expérimental Jena Jang ajoute une nouvelle couche à ce paysage sonore dense. La plupart de ses instruments sont fabriqués à la main, soudés dans des boîtes Tupperware, et produisent des sons qui n’ont rien de domestique. Sa musique se déroule comme un voyage dans le subconscient, avec des paysages sonores lourds percés d’harmoniques complexes qui ondulent à travers le chaos.

Jena Jang à la Nuit Fluxon. Credit : Kaascat
Je suis partie en train le lendemain du festival. Sur le chemin de Paris, je ne peux m’empêcher de penser aux personnes que j’ai rencontrées au cours des trois dernières semaines et aux idées et projets que nous avons échangés.
On dit qu’aucun homme n’est une île, mais les artistes et les scientifiques travaillent souvent dans l’isolement, plongés dans leurs pratiques respectives. Les retraites comme celle-ci fonctionnent comme l’eau : elles relient discrètement même les plus éloignées.
ArtLabo Retreat 2025 a été soutenu par

Par Elsa Ferreira
(Publié dans Makery le 05 juillet 2023)
Du 5 au 11 juin sur l’île de Batz, au large de Roscoff, Makery avec sa plateforme Roscosmoe, et l’association Ultra ont accueilli une trentaines de personnes, designers, artistes, et étudiants en école d’art, invitées pour apprendre, échanger et découvrir autour de l’idée de la « pensée archipélique ». « Comment travaille-t-on ensemble, vit-on ensemble, fait-on œuvre commune et comment chacun peut embarquer sur une pirogue pour aller à la rencontre des autres ? », décrivait Claire Laporte, directrice artistique de Ultra, dans notre article sur son association. En réalité, nul n’a été besoin de rappeler l’idée comme un manifeste, précise-t-elle aujourd’hui. Celle-ci s’est imposée naturellement, comme le reste de la vie en communauté, organisée en autogestion par les participants. « Les questions de circularité, de biosourcing, travailler avec des matières locales et non épuisables est un procédé naturel pour Ultra », confie Claire Laporte. Chez Makery aussi ces idées nous animent : la fabrication d’outils à partir des ressources disponibles, la circularité alimentaire… nous vous en parlons depuis presque 10 ans.
Pendant une semaine, les participants se sont ancrés dans ce territoire îlien, notamment grâce à Edouard Bal (Cueilleur d’Estran), ethnobotaniste qui a accompagné les participants à la rencontre de la flore de l’île. Les algues d’abord, puis les plantes sauvages du littoral. Une attention à l’environnement qui a été remarquée et appréciée des habitants de l’île. « Il y a eu une vraie curiosité des îliens, se réjouit Carine Le Malet, responsable de projet et coordinatrice auprès de Makery. Jeunes et moins jeunes se sont intéressés à ce qu’on faisait et nous avons été super bien accueillis. »
Alors, que s’est-il créé pendant cette retraite ilienne ? Passage en revue.

Pause pastorale
Qui : Camille Bernicot, designer graphique chargée de communication et médiation à l’association Ultra ; Ninon, en master 1 aux Beaux-Arts de Brest ; Mathieu, étudiant en 2ème année de Diplôme national des métiers d’arts et du design numérique ; Clara, en 1ère année de master de design sonore à l’école d’art et design du mans (Talm-Le Mans) et Solen, en service civique en graphisme au sein de l’association Ultra et en master 2 design et science social à l’Université rennes 2.
Quoi : Une carte sensible faite d’encres florales fabriquées à partir des fleurs trouvées sur l’île.
Comment : D’abord, il a fallu trouver les fleurs. Accompagnées de l’ethnobotaniste Edouard Bal, Camille Bernicot et son équipe partent en balade à la rencontre de la flore de l’île. « On a pris des plantes présentes en abondance pour ne pas impacter la flore, explique Camille Bernicot. La valériane et les ronces sont invasives, le lotier corniculé est l’une des premières plantes que l’on a remarqué partout sur les rochers. » Une fois la cueillette faite, les participants ont mis les fleurs dans de l’eau chaude et ont laissé infuser toute la nuit. Pour extraire les couleurs, plusieurs procédés sont possibles, expliquent-ils : « soit on épaissit la couleur avec de l’amidon de maïs, soit on crée une effervescence pour extraire le pigment du jus en ajoutant du sel d’alun et du Blanc de Meudon ». Au terme du processus, les couleurs sont recueillies sous forme d’une poudre pouvant être conservée longtemps. Ne restent plus qu’à choisir les pigments retenus : « il faut que les couleurs soient suffisamment abondantes pour qu’on puisse les reproduire en grande quantité, et qu’elles aillent bien ensemble pour se superposer ». Le coquelicot, le lotier corniculé et les ronces sont sélectionnés.
Pourquoi : La carte sensible n’a pas vocation à être géographiquement précise mais plutôt à représenter le ressenti personnel de l’île. L’équipe a donc demandé aux restes des participants de partager avec eux leurs souvenirs et anecdotes de l’île. Tous ont pu repartir avec leur carte sérigraphiée à l’encre de fleurs.

Essais d’encres florales. © Elsa Ferreira

La table de travail du groupe carte sensible. © Elsa Ferreira

Premier passage de sérigraphie pour la carte. © Elsa Ferreira
Qui : Design Social Club, designer social et utopiste ; Charlie, designer et assistant à l’association Ultra ; Marion, designer étudiant à l’Esab de Rennes, en stage à Ultra ; Blandine, étudiante en design graphique ; Théo, en service civique chez Ultra en charge de la documentation.
Quoi : De la thermocompression végétale destinée à élaborer un ensemble de céramiques biodégradables dédié à la table.
Comment : Suite d’un projet de résidence débuté à l’association Ultra il y un an, Design Social Club continue son exploration du procédé de mise en forme de végétaux par pression et chaleur sans ajout de liant. Pour ce groupe aussi, le défi était de trouver de la matière première sur place : ils ont récupéré des algues, présentes en abondance et pour certaines déjà sèches (le thermocompresseur ne peut pas presser des matières humides), les déchets des autres ateliers, notamment celui cuisine ou de la carte sensible, mais aussi les déchets post-production des acteurs de l’île. Ainsi, la brasserie locale leur a donné quantité de drèches, matière qu’il reste des céréales une fois la bière brassée.
L’équipe a également fabriqué un séchoir à partir des matériaux de récupération trouvés à la déchèterie de l’île. Les plans seront partagés en open source sur le site Flat Shape, site de partage de design d’Ultra.
Pourquoi : Réinterprétation sociale et écologique des assiettes en cartons, la bio-céramique a été utilisée pour présenter la nourriture préparée par l’atelier cuisine lors de la restitution publique. A terme, et avec des recherches supplémentaires, ces biomatériaux pourraient servir à d’autres usages, comme fabriquer des panneaux pour de l’éco-construction.

Thermocompression végétale par Design Social Club. © Elsa Ferreira

Assiettes comestibles. © Elsa Ferreira

Séchoir solaire low-tech. © Elsa Ferreira
Qui : P-node, collectif créé il y a une dizaine d’années. Il réunit des technicien.nes artistes streamers, musiciens, hackeuses, et « toute une liste de personnes qui s’intéressent à questionner le médium radiophonique », présentent-ils. C’est aussi une radio associative. Lorsqu’ils se présentent au sein du groupe, les individus préfèrent rester anonymes.
Quoi : Du radio art. « Habituellement, les ondes électromagnétiques sont utilisées pour transporter de l’information entre deux points distants – c’est ce qu’on appelle de la télécommunication, présente le collectif. Dans ce genre de projet on s’intéresse à la physicalité de l’onde, et comment travailler son essence poétique plutôt que de l’utiliser uniquement pour transformer une information. »
Comment : Le collectif réalise ce qu’il appelle des « sculptures électromagnétiques », œuvres qui font intervenir un aspect visuel, sonore, mais aussi électromagnétique. Dans l’une de ces installations, ils s’appuient sur trois phénomènes présents sur l’île : le vent, l’eau et les radios maritimes. Pour cela, les artistes fixent une antenne sur un cerf-volant très stable : « on crée un point d’infrastructure dans l’air qui nous permet d’élever des éléments à plus de 50 mètres du sol. Nous sommes donc le point le plus haut de l’île », font-ils savoir. Grâce à celle-ci, ils captent les communications maritimes des bateaux qui passent dans le rail d’Ouessant, à une centaine de kilomètres. Ils équipent la corde d’un micro qui permet de capter les vibrations du vent. Dans l’eau, à marée montante, ils placent des hydrophones. Grâce à un petit émetteur fixé lui aussi sur le cerf-volant, ils retransmettent en direct tous ces éléments vers des radios portables placées tout autour de la plage. Le résultat est une bande son méditative des sons du vent et de la mer, mêlés aux voix humaines qui contrôlent les bateaux et déroulent la météo à venir. « On attrape des choses dans l’air qui font partie de notre environnement, décrivent-ils de leur procédé. On a l’outil qui permet de rendre intelligibles ces informations qui passent en permanence au-dessus de nos têtes. » En plus de cette sculpture poétique, P-node met en place des plateaux radios agrémentés d’un « orchestre de haut-parleurs ». De cette façon, « l’espace sonore devient un espace de vie, d’échange, d’écoute ou de sieste ».
Pourquoi : Ces œuvres sont éphémères et liées par essence au paysage dans lequel elles prennent vie – c’est aussi cette « légèreté et délicatesse d’attraper des choses de façon parcimonieuse » qui leur plaît. Mais certaines pistes ont été évoquées pour faire perdurer l’œuvre sonore enregistrée depuis le cerf-volant. A suivre.

Dans les mains de P-node, le cerf-volant devient une base pour émettre et recevoir © Elsa Ferreira

Un plateau radio et ses spectateurs. © Elsa Ferreira
Qui : Joanna Wong, artiste plasticienne et cofondatrice du collectif Enoki, elle travaille la cuisine comme médium pour parler de migration ; Lola, étudiante en première année de master à Brest ; Arbol, étudiante colombienne aux Beaux-Arts de Caen ; Camille, en 2ème année à HEAR Strasbourg.
Quoi : Une expérimentation culinaire pour valoriser les ingrédients de l’île tout en reflétant le patrimoine et les racines de chacun.
Comment : Artiste plasticienne adepte des installations culinaires, Joanna Wong explore les implications politiques de la cuisine. Hongkongaise basée à Paris, elle défend l’idée que « notre umami, notre palais de goût, notre patrimoine culinaire dépend d’où et comment on grandit, de notre éducation, de notre parcours et avec qui on a cuisiné. Donnez un œuf et un champignon à dix personnes différentes, vous aurez dix recettes différentes, dit-elle. Chaque fois que l’on cuisine, c’est une mise en forme de notre parcours ». Comment, en tant que migrant, recréer un patrimoine culinaire, interroge-t-elle ? Sur l’île de Batz, elle donne forme à cette pensée. En glanant les aliments sur place, elle rend compte des similitudes entre la cuisine de l’île bretonne et celle de son île natale. Les algues lui rappellent les noris snackés, encas très populaire à Hong Kong, le sarrasin fait écho aux nouilles soba. L’expérimentation est concrète puisque les membres de l’atelier ont préparé les repas pour l’ensemble des participants de la retraite.
Pour la restitution publique, l’équipe a mis en place un atelier ravioli, à cuisiner à partir d’ingrédients locaux : les pommes de terre et les radis cultivés sur l’île, les oignons roses de Roscoff. L’aliment est prompt à interroger les racines et le patrimoine culturel de la nourriture, illustre Joanna Wong : « si tu trouves tous les ingrédients en Italie, est-ce que c’est encore un ravioli chinois ? Et si c’est un Italien qui le cuisine ? Et si c’est un ravioli italien cuisiné par un Chinois ? ».
Pourquoi : Pour Joanna Wong, chaque geste de cuisine est un geste d’adaptation. Il permet aussi de réunir les gens autour d’une table pour aborder des problématiques pourtant parfois compliquées, estime-t-elle. « Quand j’organise des installations culinaires je ne dis pas, « viens voir une performance artistique », je dis « viens manger » ». Une proposition plus qu’alléchante.

Ravioli cooking session. © Elsa Ferreira

Kefir, popcorn et assiettes comestibles pour les journées portes ouvertes. © Elsa Ferreira
Homo Photosyntheticus, recherche de terrain
Qui : Ewen Chardronnet, artiste et rédacteur en chef de Makery ; Julie Verin, artiste et designer ; Arthur Barbe, artiste multimédia ; Léonore Bonaccini et Xavier Fourt pour leur duo Bureau d’études.
Quoi : un travail de recherche sur les algues dans toute ses potentialités pour la transition écologique : les algues alimentaires, la pollution aux algues, les usages médicinaux, la recherche spatiale, le biocarburant, la captation carbone, les biomatériaux…
Comment : Dans ce projet à long terme, né en 2021, le collectif d’artistes construit une base de connaissances et la documente, en particulier en vidéo. Ils interviewent des spécialistes dans ce qui deviendra une matrice interactive où le spectateur pourra choisir le thème qu’il souhaite explorer. Sur l’île, retour au terrain avec les balades de l’ethnobotaniste Edouard Bal, dans une exploration toujours capturée en vidéo. Julie Verin explore les méthodes de conservation des algues et les films avec un microscope caméra. Le collectif se réserve aussi des moments de discussions et réfléchit aux formes que vont prendre les publications et reconstitutions.
Balade autour des algues de l’île, par Edouard Bal. Réalisation et montage, Quentin Aurat :
Pourquoi : Homo Photosyntheticus a déjà présenté certains de ces travaux, notamment un dîner-installation autour des algues réalisé par Maya Minder. Le collectif noue des partenariats et diffuse ses créations protéiformes dans des structures artistiques comme Antre-Peaux, partenaire du projet, ou le Jeu de Paume. A long terme, un documentaire sera aussi produit. « On essaie de sortir des choses régulièrement pour animer et enrichir le projet », résume Ewen Chardronnet.

Ballade au coeur des algues. © Carine Le Malet

Table de lecture. © Elsa Ferreira
ArtLabo Retreat est un rassemblement international bi-annuel d’une semaine. Il se déroule sur l’île de Batz, au large de Roscoff (Bretagne, FR). Il est axée sur le partage de pratiques de recherche-création dans le domaine de la biologie marine, des biomatériaux, de l’alimentation durable, de l’upcycling et de l’économie circulaire, des technologies open source, des arts vidéo et sonores et de la publication de médias.
En 2023, ArtLabo Retreat est organisé par ART2M/Makery en partenariat avec Association Ultra (Le Relecq-Kerhuon) et conviera des invités nationaux et internationaux à encadrer des ateliers axés sur : les pratiques de bioart liées à la biologie de l’évolution et à la biologie marine ; la photosynthèse globale des algues et la systémique de l’énergie solaire ; l’ethnobotanique des algues comestibles, la recherche d’algues et la cuisine ; l’économie circulaire, le design durable, le recyclage et les biomatériaux ; les pratiques hypermédiatiques liées à ces domaines.
Les retraites ArtLabo font partie du réseau Feral Labs et sont cofinancées par l’Union européenne – Feral Labs (2019-2021) et Rewilding Cultures (2022-2026).
Le projet Rewilding Cultures (RC) veut repositionner le sauvage après le COVID et se concentrer sur l’inclusivité et l’écologie dans le domaine de l’art, de la science et de la technologie. Un nouveau regard sur ce secteur est nécessaire et l’arrêt de tout ce qui se fait par COVID nous offre un moment inconfortable, mais nécessaire, de réflexion sur les changements potentiels. Nous ne pouvons pas revenir au statu quo, surtout en termes de pollution et de non-prise en compte d’importantes questions d’inclusion. Nous devons redonner vie à la nature dans des conditions adaptées au présent et à l’avenir.
Au cours des dix dernières années, nous avons assisté à une forte croissance de divers hubs créatifs, de laboratoires et d’espaces de coworking, de fabrication, de biologie et d’art. Ils se présentent sous de nombreuses formes et tailles et fonctionnent comme des initiatives qui offrent aux participants un espace social équipé d’opportunités technologiques, un espace où chacun est encouragé à expérimenter, explorer, créer et partager. L’importance de l’aspect social et communautaire est l’un des aspects les plus importants de ces Creative Hubs ; ils ne sont pas seulement des lieux de prototypage rapide et répondent aux besoins des artistes et des fabricants, ils sont bien plus que des machines et des outils de fabrication et leurs opérateurs. Ce sont des lieux de vie sociale riche et des foyers de communautés diverses. Les Creative Hubs sont désormais des facilitateurs indispensables de la science ouverte et citoyenne, de la localisation de la production, des nouveaux modèles économiques, des testeurs et des développeurs des technologies du futur, ainsi que des lieux d’utilisation nouvelle et innovante des anciennes technologies. Ce sont des lieux de réinvention et d’innovation dans les processus d’éducation et d’apprentissage tout au long de la vie.
https://rewildingcultures.net/
Plus d’infos: contact@makery.info

SOUTENU PAR
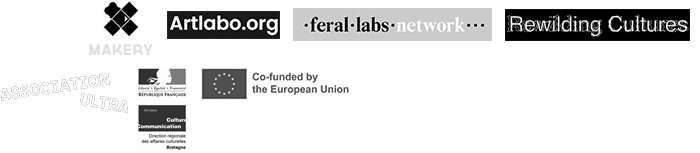
par Roland Fischer
(publié dans Makery le 20 septembre 2020)
Du 16 au 24 août 2020, le premier “ArtLabo Retreat” a eu lieu à l’Ile de Batz, en France. Le rendez-vous était conçu comme une rencontre du réseau ArtLabo, et faisait partie de la série des événements Feral Labs Network, un programme Europe Créative lancé depuis 2019. Roland Fischer, du Symbiont.Space à Bâle, revient sur son expérience à l’Île de Batz.
La périphérie est le nouveau centre. Et vice versa. Paris était presque vide à la mi-août, mais je n’étais que de passage. Trois heures de plus vers l’ouest, le TGV était bien rempli. La pluie m’a accueilli à Morlaix, une autre demi-heure plus tard, je me suis assis à la terrasse d’un café à Roscoff. L’air était salé, la pluie avait cessé, le temps change rapidement par ici. Destination l’Ile de Batz, coefficient de marée : maximal. Température : minimale.
Une exception géographique, un lieu idéal pour une semaine d’échange avec des personnes de toute l’Europe travaillant sur des projets artistiques/scientifiques. C’est du moins ce qui était prévu avant que Corona ne nous frappe à sa manière symbiotique particulière. Bien qu’il s’est avéré que la Bretagne constituait une sorte de refuge – l’incidence du virus y étant parmi les plus faibles d’Europe – de nombreux participants qui devaient venir de l’étranger avaient néanmoins décidé de rester chez eux, vu les restrictions sur les déplacements. On constatait que les Français avaient cependant choisi de venir en grand nombre – le littoral de la Bretagne n’a jamais connu de semaines de vacances aussi chargées.
Ainsi, parmi la foule de touristes, quelque 20 à 30 personnes ayant des intérêts qui diffèrent de la promenade et des bains de soleil, se retrouvaient sur l’île de Batz pour une longue semaine d’expériences et de discussions. Dans le cadre de ses activités au sein du réseau européen Feral Labs Network, Makery y organisait son premier summer camp : ArtLabo Retreat. Cette retraite était conçue comme une rencontre entre le réseau européen Feral Labs et le réseau français ArtLabo, ces deux réseaux partageant des pratiques de recherche-création au croisement Art/Société/Technologies.

Le thème de la retraite : la symbiose, en termes très généraux. Des partenariats à long terme entre organismes, unissant différentes compétences ou aptitudes, donnent à l’ensemble d’un système une sorte de « mise à niveau » – ce qui vaut bien sûr pour de nombreuses pratiques artistiques, en particulier pour les projets à l’intersection de l’art, de la technologie et de la science.
Il était donc tout à fait approprié de commencer la retraite par une projection du documentaire Symbiotic Earth sur la vie de la biologiste de l’évolution Lynn Margulis. Margulis est une figure éminente de la biologie moderne. Mais au début de sa carrière, son idée audacieuse, bien que paraissant aujourd’hui en quelque sorte évidente – l’évolution n’est pas un processus continu, elle se fait parfois par bonds – fut souvent ridiculisée. Les aptitudes évoluent selon chaque formes de vie indépendantes, et quelque chose de totalement nouveau et de beaucoup plus intéressant émerge lorsque deux de ces « prototypes » fusionnent. Elle appelle cela la symbiogenèse. Au lieu de la vision mécaniste selon laquelle la vie évolue par le biais de mutations génétiques aléatoires et de la compétition, Margulis présente un récit symbiotique dans lequel les bactéries s’unissent pour créer les cellules complexes qui forment les animaux, les plantes et tous les autres organismes – qui constituent ensemble une entité vivante multidimensionnelle qui recouvre la Terre. Ce qui signifie également que les humains ne sont pas le sommet de la vie avec le droit d’exploiter la nature, mais qu’ils font partie de ce système cognitif complexe. Ou, comme le dit Margulis dans le film : « Les bactéries sont là depuis des milliards d’années, bien avant notre arrivée. Elles dirigent le monde. » On pourrait ajouter : les virus font certainement aussi partie de cet ancien empire. Ils pourraient même être les rois discrets de la symbiose, mais c’est une autre histoire.
La projection était suivie d’une discussion menée par Xavier Bailly, chercheur du laboratoire Modèles Marins Multicellulaires de la Station Biologique de Roscoff, expert du héros symbiotique local : Symsagittifera roscoffensis, un ver marin qui ingère des algues pour les utiliser comme source d’énergie – un « animal-plante » vraiment exceptionnel du littoral breton. Sa présentation a suscité des discussions sur la symbiose par rapport au parasitisme. Qui exploite qui dans cette fusion de l’animal et des algues ? La symbiose est-elle toujours bénéfique pour les deux partenaires ? Surprise : il s’avère que selon Wikipedia, nous nous sommes trompés de symbiose depuis le début : La symbiose (du grec συμβίωσις, sumbíōsis, « vivre ensemble », de σύν, sún, « ensemble », et βίωσις, bíōsis, « vivre ») est tout type d’interaction biologique étroite et à long terme entre deux organismes biologiques différents, qu’elle soit mutualiste, commensitaire ou parasitaire.
Ainsi, même les parasites peuvent être des symbiotes ? On dirait que la nature n’insiste pas tant que ça sur les accords consensuels. Xavier Bailly montrait quelques images prises dans son laboratoire exposant les algues sous des formes très « non naturelles ». On dirait presque qu’elles essaient constamment de fuir leur nouvel habitat à l’intérieur du corps du ver. Qu’en est-il des arts alors ? Comment s’arrangent les structures de pouvoir lorsqu’il s’agit de collaborations entre art et science ? Qui circonscrit qui dans ce cas ? Trop souvent encore, ce genre de projets est façonné par des hiérarchies cachées – il suffit de suivre l’argent. Et les scientifiques ont tendance à exploiter les arts pour leurs besoins – de vulgarisation, d’illustration, de créativité (alias « penser out of the box »). Dans ces contextes, les métaphores du mutuel et du parasitaire peuvent être utiles pour réfléchir aux cadres structurels et politiques des collaborations artistiques, alors que Margulis elle-même mettait en garde contre les dangers d’utiliser des concepts anthropomorphiques pour décrire ou analyser des phénomènes biologiques.
Le projet Roscosmoe, animé par Ewen Chardronnet (de Makery, ndlr), invitait les artistes Olivier Morvan et Miha Turšič et pousse l’histoire du Symsagittifera roscoffensis un petit pas (ou plutôt un grand saut ?) plus loin, dans l’espace. L’objectif du projet : raconter le voyage du Symsagittifera roscoffensis et les étapes de sa sélection comme « candidat cosmonaute » en vue de son éventuel départ pour l’espace extraterrestre. Faut-il voir dans l’ »animal-plante » le parfait explorateur de l’espace, ne vivant que de l’énergie du soleil ?
En parlant d’énergie solaire, l’Energylab, animé par Cédric Carles et Loïc Rogard de l’Atelier21, présentait des innovations fantastiques de l’histoire de l’énergie, des dispositifs précurseurs qui n’étaient pas considérés comme pertinents ou fiables à leur époque, qui n’ont pas trouvé d’utilisateurs intéressés ou qui manquaient d’une brique technique pour rendre le système efficace. Comme ils disent : « Inhaler le passé, Expirer le futur, Voler avec le soleil ». Un descendant récent des pionniers du vol solaire était également présent sur l’île. Suivant les conditions météorologiques, un vol du ballon solaire Aerocene Backpack de la Communauté Aérocène France avait été prévu, avec l’espoir d’emmener une caméra Go Pro en hauteur. Mais, comme nous l’avons déjà dit : la météo change rapidement ici, et après un moment de soleil, trop de nuages prenaient place, si bien que le ballon finissait par devenir un énorme jouet noir et surréaliste pour les enfants sur la plage plutôt qu’un équipement de recherche. Une variante qui fonctionnait cela dit à merveille..
Un peu plus tard, Joachim Montessuis invitait les participants à un groupe de réflexion, un groupe de discussion-débat éphémère sur l’art et la conscience, s’appuyant sur ses cours à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg sur le son et la spiritualité. Les méandres du dualisme : l’ego subjectif de l’artiste (ou même l’ego collectif) est-il encore une notion suffisante de nos jours ? Peut-on dépasser la binarité existentialiste de l’ego de l’artiste qui est maître de sa réalité et de son destin, afin d’en faire une expérience plus profonde ? Qui crée, pour qui, et à quel profit ? Et voilà que reviennent la symbiose et le parasitisme.
Une spiritualité plus substantielle : j’avais décidé d’étendre mes expériences de maturation sonore aux liqueurs locales, en l’occurrence à du calva, en le traitant avec de fortes doses d’énergie ultrasonique. S’agit-il de chimie physique ou de charlatanisme de la succussion, comme le pratiquent les homéopathes ? Qu’arrive-t-il aux alcools forts lorsqu’ils sont stimulés par des ondes ultrasoniques ? Lorsqu’ils sont secoués très fort, de l’intérieur vers l’extérieur ? Il y a une tradition à ce sujet : « La couleur et la saveur du bourbon du Kentucky viennent du balancement de la navigation. Le bourbon était chargé sur les bateaux dans le Kentucky, et le temps qu’il voyage jusqu’aux gens qui l’achetaient, le goût s’améliorait ».
Le documentaire de Margulis trouvait un écho surprenant deux jours plus tard dans Spaceship Earth, un film qui s’achève sur le partenariat le plus improbable du capitalisme tardif : Biosphere 2 et Steve Bannon. Dommage que les deux films soient terriblement conventionnels, artistiquement parlant. Des narrations à la première personne, des têtes parlantes. Certains des projets présentés proposaient pourtant des expériences quelque peu différentes et plus rhizomiques dans la pratique culturelle et technologique.
Une équipe de membres de MyOwnDocumenta (Corisande Bonnin, Charlotte Imbault, Dominique Petitgand) avait également rejoint le camp éphémère, MyOwnDocumenta (une revue en ligne de journaux d’artistes hébergé par David Guez) étant un groupe qui s’accorde sur le fait que le processus est sans doute plus important que le résultat final – ce qui était certainement le cas dans les discussions du réseau ArtLabo, animé par Julien Bellanger et Catherine Lenoble. Leur atelier a eu lieu toute la semaine dans l’atelier de la colonie de vacances, un espace magnifiquement étrange rempli de jouets, d’accessoires de peinture, de restes de vacances. Là, les hôtes invitaient tous les participants à discuter et à tester des outils et des pratiques liés à la documentation et au récit de nos expériences vers une plus grande autonomie numérique. En cours de route, la colonie de vacances est devenue une station de radio éphémère, diffusant sur Pi-node. Envoyer des signaux dans l’obscurité. Tout comme le phare sur la colline au-dessus de la colonie, où le projecteur tournait et tournait, faisant clignoter son message vers les mers noires. Mais attendez, peut-on dire qu’il y à un signal même quand il n’y a personne pour le voir ?
Depuis 2015, Makery est membre du réseau ArtLabo. L’ArtLabo Retreat 2020 est une rencontre entre le réseau européen Feral Labs et le réseau français ArtLabo, deux réseaux partageant des pratiques de recherche-création Art/Société/Technologies.
En raison de Covid-19, l’ArtLabo Retreat a cependant dû réduire son personnel et renoncer à un appel à projets.
le réseau Feral Labs
Réseau de centres temporaires et délocalisés pour la recherche en art, technologie et communautés, le réseau Feral Labs est composé de six partenaires de six pays de l’UE, réunis par leur intérêt commun pour la recherche en art et science, et les communautés contemporaines de Do-It-Yourself (DIY) et Do-It-With-Others (DIWO). Plutôt que de se concentrer sur des modes de présentation tels que les expositions et les festivals, le réseau Feral Labs s’attache à connecter et à organiser une série de camps et d’environnements créatifs temporaires de format similaire, en mettant l’accent sur des activités basées sur des processus tels que l’apprentissage par les pairs, le travail de terrain, la recherche et la co-création. Ces activités ont en commun d’être délibérément placées dans un environnement éloigné, loin du cadre urbain habituel des centres de création contemporains. Au cours des deux dernières années, les partenaires du projet ont créé une variété de pôles créatifs temporaires qui varient en termes de portée, de format et de sujets couverts, mais qui ont tous un point de départ méthodologique commun : temporaire, international, distant, ouvert et transdisciplinaire (art-technologie-science).
Le réseau Feral Labs a été initié et coordonné par Projekt Atol Institute (SI) en partenariat avec Makery/Digital Art International (FR), Catch/Helsingør Kommune (DK), SCHMIEDE HALLEIN – Verein zur Förderung der digitalen Kultur (AT), Bioart Society (FI) et Udruga za razvoj uradi sam kulture Radiona (HR).
Le réseau ArtLabo
Depuis sa création informelle vers 2004, ArtLabo est animé par des structures telles que Labomedia (Orléans), le PIB (Tours), le Lieu multiple (Poitiers), Bandits-Mages (Bourges) et PiNG (Nantes), mais surtout par de nombreuses personnes impliquées dans des territoires communs de recherche-action. ArtLabo organise des rencontres depuis de nombreuses années, 0camp à Nantes en 2015, 1camp en 2016, ou encore lors des Human Tech Days / Rencontres Arts & Sciences Friction à Bourges en janvier 2020. Le principe : à partir d’un axe de travail commun, les structures partenaires, ainsi qu’un large réseau d’intervenants, testent pendant une période donnée l’exploration collective d’un sujet autour d’un programme, de débats ou d’une série coordonnée d’actions communes.
ArtLab
Julien Bellanger et Catherine Lenoble
Selon la philosophie des projets collaboratifs et des échanges informels, l’atelier ArtLabo Retreat 2020 sera l’occasion de discuter et de tester des outils et des pratiques liés à la documentation et au récit de nos expériences vers plus d’autonomie numérique(Radio, pad writing avec CodimD, system autonomes ou non, etc).
Roscosmoe
Ewen Chardronnet
L’objectif du projet Roscosmoe est de raconter le parcours du Symsagittifera roscoffensis, un ver marin symbiotique, un « animal-plante » exceptionnel du littoral breton, dans les étapes de sa sélection comme « candidat cosmonaute » en vue de son éventuel départ pour l’espace extraterrestre. Roscosmoe est un récit spéculatif qui explore la théorie endosymbiotique de l’évolution (Lynn Margulis), notre nature multi-espèces, la fragilité des symbioses et des environnements marins face au réchauffement climatique, à l’acidification des océans et aux influences anthropiques, les notions d’écologie spatiale et d’étude du vivant et l’évolution de la vie face à des conditions de gravité variable. Le projet Roscosmoe vise à créer une installation artistique qui prendra la forme d’un aquarium bathyscaphe connecté et autosuffisant contenant une colonie de vers marins dans l’eau de mer. Ce prototype spéculatif d’un futur module de recherche pour une station spatiale sera entouré de dispositifs multimédia offrant les données vitales et environnementales du dispositif en temps réel, d’un système de multidiffusion des différentes étapes de la sélection du « candidat-cosmonaute ». L’objectif de l’atelier sur l’île de Batz est de se familiariser avec l’espèce Symsagittifera roscoffensis et de déterminer les processus de scénarisation du récit spéculatif autour du projet Roscosmoe.
Symbiotic Earth
Xavier Bailly et Ewen Chardronnet
Projection du documentaire Symbiotic Earth sur la biologiste évolutionniste Lynn Margulis sur deux matinées les mardi 18 et mercredi 19 août, suivie d’une discussion autour du film le 19 conduite par Xavier Bailly, chercheur du laboratoire Modèles marins multicellulaires de la Station biologique de Roscoff.
SYMBIOTIC EARTH explore la vie et les idées de Lynn Margulis, une scientifique brillante et radicale, dont les théories non conventionnelles ont défié la communauté scientifique dominée par les hommes et changent aujourd’hui fondamentalement notre regard sur nous-mêmes, l’évolution et l’environnement.
Jeune scientifique dans les années 1960, Margulis a été ridiculisée lorsqu’elle a proposé pour la première fois que la symbiose était un moteur essentiel de l’évolution, mais elle a persisté. Au lieu de la vision mécaniste selon laquelle la vie a évolué par le biais de mutations génétiques aléatoires et de la compétition, elle a présenté un récit symbiotique dans lequel les bactéries se sont unies pour créer les cellules complexes qui ont formé les animaux, les plantes et tous les autres organismes – qui forment ensemble une entité vivante multidimensionnelle qui recouvre la Terre. Les humains ne sont pas le summum de la vie avec le droit d’exploiter la nature, mais font partie de ce système cognitif complexe dans lequel chacune de nos actions a des répercussions.
Le cinéaste John Feldman a voyagé dans le monde entier pour rencontrer les collègues avant-gardistes de Margulis et s’est constamment interrogé : Que se passe-t-il quand la vérité change ? SYMBIOTIC EARTH examine la vision du monde qui a conduit au changement climatique et au capitalisme extrême et propose une nouvelle approche de la compréhension de la vie qui encourage un mode de vie durable et symbiotique.
ATELIER21 ENERGYLAB: “Inhale the past, Exhale the future, Fly with the sun”
Cédric Carles et Loïc Rogard
L’histoire de l’énergie regorge d’innovations fantastiques, de dispositifs précurseurs qui n’ont pas été jugés pertinents ou fiables en leur temps, n’ont pas trouvé d’utilisateurs intéressés ou manquaient d’une brique technique pour rendre le système efficace. Pourtant, ces inventions oubliées sont aujourd’hui en mesure de répondre favorablement et probablement de manière inattendue aux défis du monde à venir. Cette nouvelle écriture de l’histoire de l’énergie appelle une vision globale qui permette de passer à d’autres phases fécondes d’analyse et de création. La méthodologie de la plateforme paleo-energetique.org propose donc d’explorer le domaine public, les retrotechs et les lowtechs afin de dénicher des innovations injustement oubliées. » Inhale the past, Exhale the future » : la Retraite Arte Labo sera l’occasion d’une rétrospective autour de la fondation Aerocene, pour rassembler une iconographie collective et reconstituer une histoire des vols et des machines à voler, toutes plus folles les unes que les autres, y compris celles utilisant le vélo ou l’énergie solaire. « Volez avec le soleil », en fonction de la météo, nous pourrons organiser des vols avec le ballon solaire Aerocene Backpack d’Aerocene Community France, il sera possible de prendre des photos avec des go pro, de tester le poids maximum pouvant être soulevé par le ballon, etc…).
Site web Atelier21.
Expériences de maturation sonique : traitement de boissons avec de fortes doses d’énergie ultrasonique.
Roland Fischer
Est-ce de la physico-chimie ou du charlatanisme ? Qu’arrive-t-il aux alcools forts lorsqu’ils sont stimulés par des ondes ultrasoniques ? Quand on les secoue très fort, de l’intérieur vers l’extérieur ?
« La couleur et la saveur du bourbon du Kentucky proviennent du bercement sur l’eau. Le bourbon était chargé sur les bateaux au Kentucky, et le temps qu’il voyage jusqu’aux personnes qui l’achetaient, la saveur s’améliorait. »
THINK TANK, groupe de discussion éphémère autour de :
Art et conscience (non-dualité et pensées non-binaires)
Joachim Montessuis
Des Vedas (connaissance) au latin Scientia (savoir), jusqu’à l’Intelligence Artificielle en passant par le quantique, nous sommes amenés à expérimenter notre rapport au réel soit avec une approche classique dualiste et objective, soit avec une approche plus subtile, très ancienne et très actuelle : la non-distinction entre conscience et matière. Cette approche redéfinit complètement notre rapport à la réalité, à l’espace social, politique et donc artistique. Mais quelles sont réellement les différences entre le dualisme et le non-dualisme ?
L’ego subjectif de l’artiste (ou même l’ego collectif) est-il encore une notion suffisante de nos jours ? Peut-on dépasser la binarité existentialiste de l’ego de l’artiste maître de sa réalité et de son destin, afin d’avoir une expérience plus profonde ? Qui crée, pour qui, et à quel bénéfice ? L’éveil non-duel est-il la dernière avant-garde dans un monde mutant ?
Participants et résidents de ArtLabo Retreat:
Xavier Bailly (Laboratoire M3, Station Biologique de Roscoff, Fr)
Charlotte Bartissol (Atelier21, Fr)
Julien Bellanger (Ping, Fr)
Corisande Bonnin (Fr)
Cédric Carles (Atelier21, Fr)
Ewen Chardronnet (Makery, Fr)
Shu Lea Cheang (Tw/US/Fr)
Florence Cherrier (ArtLab – Mains d’œuvres & La Station, Fr)
Julie Corre (Fr)
Eric Daviron (Collectif Mu & La Station, Fr)
Roland Fischer (Symbiont.space, Ch)
Clément Gasque (GDP, Fr)
David Guez (MyOwnDocumenta, fr)
Agathe Herry (Fr)
Charlotte Imbault (Fr)
Wolf Kuehr (Volumes, De/Fr)
Olivier Le Gal (Collectif Mu & La Station, Fr)
Catherine Lenoble (PIB, Fr)
Alice Marsal (Fr)
Anne Métrard (Fr)
Joachim Montessuis (Fr)
Florence Morat (Fr)
Olivier Morvan (Fr)
Dominique Petigand (Fr)
François Robin (Makery, Fr)
Loïc Rogard (Atelier21, Fr)
Gaël Segalen (Fr)
Lionel Sayag (Fr)
Marc Swyngedauw (Fr)
Anaïs Tondeur (Watermarks, Fr)
Miha Turšič (Waag, Si/Nl)
SOUTENU PAR